
Fontaine en ruine sur le site du village olympique de 2004 à Athènes Source: AP
L’information va poser rapidement un gros problème au Comité International Olympique. Pour les Jeux Olympiques d’hiver de 2022, trois candidatures étaient jusque là en lice : Pékin en Chine, Almaty au Kazakhstan et Oslo en Norvège. La capitale européenne a jeté l’éponge, la population refusant d’avoir à assumer des investissements pharaoniques pour une manifestation sportive de 15 jours qui laisse derrière elle des installations dont on ne sait que faire. La multiplication des articles sur les sites olympiques à l’abandon ne vient pas aider le CIO à convaincre du contraire.
Otage ou complice des sponsors ?
Selon le C.I.O., le bon développement des Jeux Olympiques nécessite des sommes considérables. Ce postulat a conduit le comité à vendre les J.O. à des multinationales qui, en échange de leur mécénat, cherchent un retour sur investissement conséquent.
Le C.I.O. autorise donc les actions suivantes à ses partenaires privés :
- Le droit d’utilisation de toute l’imagerie olympique ainsi que les désignations olympiques appropriées sur les produits
- La possibilité d’accueil aux Jeux Olympiques
- Une publicité directe et des opportunités promotionnelles, y compris un accès préférentiel à la publicité au cours de la diffusion olympique
- Des concessions sur site / franchises et vente de produits / opportunités de représentation
- Une protection contre le marketing pirate
- La reconnaissance de leur soutien au travers d’un vaste programme de reconnaissance envers le parrainage olympique.
Sans surprise, les sponsors les mettent en action. Ainsi, lors des derniers Jeux Olympiques de Londres en 2012, les visiteurs ne pouvaient utiliser leur carte de crédit si elle n’était pas une Visa. Clients AmEx, payez en cash ! Porter un vêtement publicitaire pour un concurrent de Coca-Cola ? On n’entre pas sur le site, même quand vous avez payé votre billet.
le C.I.O. a une définition de l’olympisme :
« L’Olympisme est une philosophie de la vie, exaltant et combinant en un ensemble équilibré les qualités du corps, de la volonté et de l’esprit. Alliant le sport à la culture et à l’éducation, l’Olympisme se veut créateur d’un style de vie fondé sur la joie dans l’effort, la valeur éducative du bon exemple et le respect des principes éthiques fondamentaux universels »
Pendant les jeux, cette définition est toujours valable, mais seulement si elle se fait aux couleurs et conditions des sponsors. Sacrée limitation.
Otage des régimes politiques ?
Les besoins financiers du C.I.O. l’ont aussi conduit à accepter des candidatures émanant de pays prêts à mettre beaucoup d’argent sur la table, mais qui ne respectent pas plus la charte olympique que les sponsors. La Charte Olympique est pourtant très claire :
« Toute forme de discrimination à l’égard d’un pays ou d’une personne fondée sur des considérations de race, de religion, de politique, de sexe ou autres est incompatible avec l’appartenance au Mouvement olympique. »
Que va donc pouvoir faire le C.I.O. face à la candidature kazakh ? Ce pays présente une situation peu reluisante des droits de l’homme. pratique de la torture, arrestations arbitraires, violation de la liberté religieuse et de la liberté d’expression, repression des orientations sexuelles minoritaires, le Kazakhstan n’est pas en mesure de prouver son adhésion à la Charte Olympique.
Malheureusement, la Chine n’est pas plus en mesure de démontrer son respect de la Charte Olympique que le Kazakhstan. Là aussi, les violations des libertés religieuses, libertés d’expression, respect des minorités sexuelles etc sont patentes et relevées par les organisations non gouvernementales comme Human Right Watch.
Dès lors, les Jeux Olympiques d’hiver de 2022 sont-ils menacés ? le C.I.O. va-t-il faire pression sur certains pays membres afin qu’ils respectent la charte olympique comme ils se doivent de le faire ? En fait non. Le Comité International Olympique regrette la décision norvégienne mais rejette la responsabilité sur les politiques de ce pays qui, selon lui, n’ont pas fait leur boulot et «pris leur décision en se basant sur des demi-vérités ou des inexactitudes.»
Otage des réseaux sociaux ?
Une source proche du comité va même plus loin. Pour le moment, la défection norvégienne n’est due qu’à une minorité d’activistes dont le seul but est de critiquer les jeux.
« La difficulté des pays matures, c’est de mobiliser la population, de ne pas donner d’espace à cette minorité tapageuse qui critique les Jeux », analyse un expert, engagé auprès du CIO. « Les candidatures communiquent traditionnellement vers l’extérieur, l’étranger. Depuis l’explosion d’internet et des réseaux sociaux, parce qu’un petit groupe peut se donner beaucoup d’importance, il faut d’abord communiquer vers les habitants de son propre pays », reprend-il. (arcinfo.ch)
Difficile à croire, mais l’ennemi des J.O., c’est l’internaute tapageur sur les réseaux sociaux. Vraiment ?








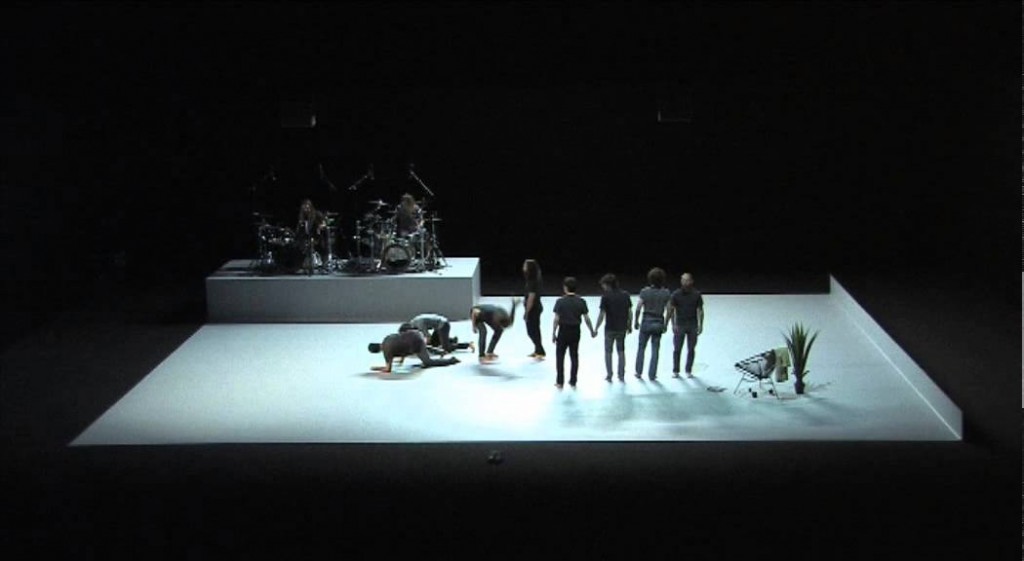
 Les jeux olympiques sont sans doute l’un des événements les plus consensuels de la planète. Tous les 2 ans, jeux d’hiver ou jeux d’été ont vocation à faire battre les coeurs de l’humanité à l’unisson. Rien n’est trop beau, rien n’est trop grand, rien n’est trop grandiloquent. Pendant deux semaines, les nations de la planète s’affrontent sur le stade dans une compétition « fraternelle » où elles envoient leurs meilleur.e.s champion.ne.s. pour ramener gloire personnelle et fierté nationale.
Les jeux olympiques sont sans doute l’un des événements les plus consensuels de la planète. Tous les 2 ans, jeux d’hiver ou jeux d’été ont vocation à faire battre les coeurs de l’humanité à l’unisson. Rien n’est trop beau, rien n’est trop grand, rien n’est trop grandiloquent. Pendant deux semaines, les nations de la planète s’affrontent sur le stade dans une compétition « fraternelle » où elles envoient leurs meilleur.e.s champion.ne.s. pour ramener gloire personnelle et fierté nationale. Mais les villes olympiques ne sont les seules à devoir payer une facture élevée. Les femmes et les hommes, les champions olympiques ont, eux aussi, des lendemains difficiles, une fois la fête finie. Personne ne devient champion olympique par hazard et la montée sur le podium vient couronner une vie consacrée à une activité sportive, parfois au détriment de tout le reste. Les athlètes ont pour la plupart, dès leur plus jeune âge, rythmé leur vie par des entrainements intensifs quotidiens. Vivant en marge de leurs camarades d’école, le vie est tout entière focalisée sur un objectif unique : arriver au top.
Mais les villes olympiques ne sont les seules à devoir payer une facture élevée. Les femmes et les hommes, les champions olympiques ont, eux aussi, des lendemains difficiles, une fois la fête finie. Personne ne devient champion olympique par hazard et la montée sur le podium vient couronner une vie consacrée à une activité sportive, parfois au détriment de tout le reste. Les athlètes ont pour la plupart, dès leur plus jeune âge, rythmé leur vie par des entrainements intensifs quotidiens. Vivant en marge de leurs camarades d’école, le vie est tout entière focalisée sur un objectif unique : arriver au top.
Commentaires récents